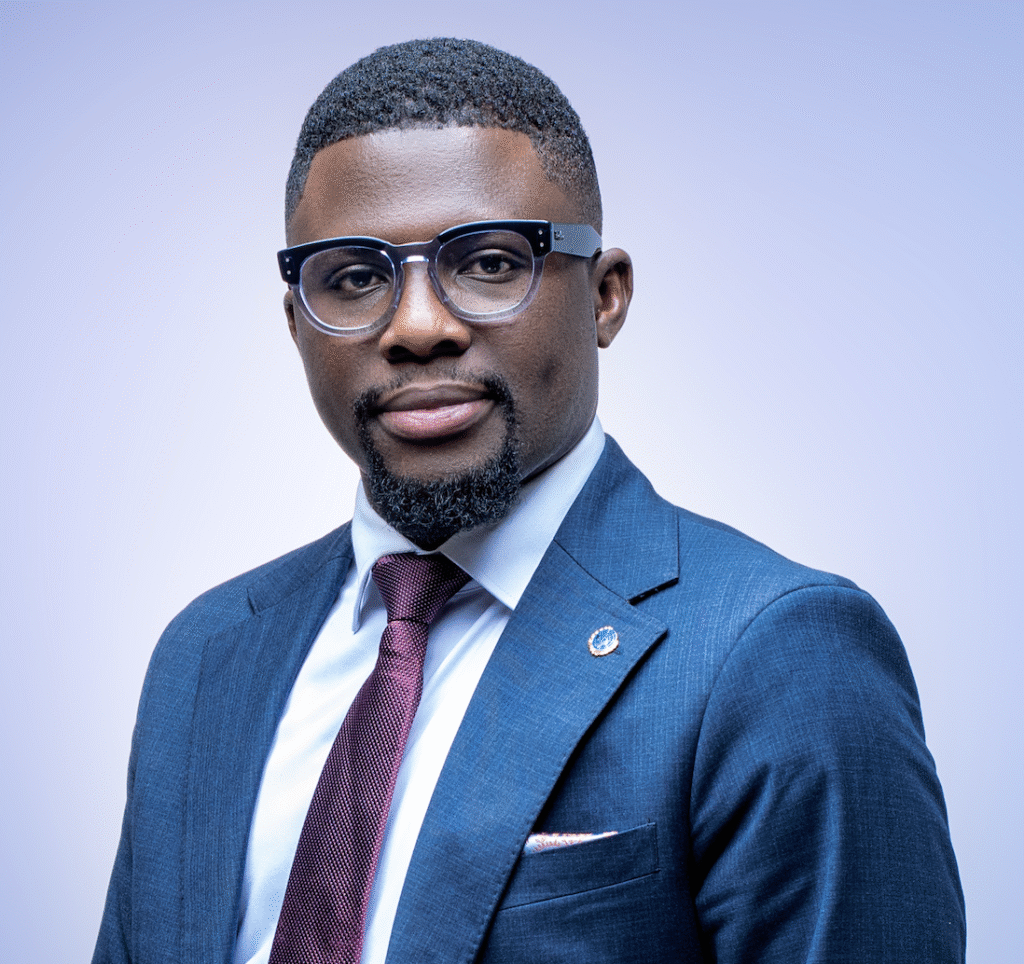
Au matin du 1er mars 1896, le froid de l’aube enveloppait les montagnes d’Adoua. La brume descendait dans les vallées tandis que des milliers de feux de camp s’éteignaient doucement, leur fumée montant vers le ciel. Le sol vibrait sous les pas des hommes et des femmes qui avaient marché des jours durant. Ils venaient du Choa, du Tigré, du Wollo, du Godjam et d’au-delà. Certains portaient des fusils, d’autres des lances, beaucoup seulement leur foi et leur détermination. Des prêtres levaient haut des croix de bois, des femmes circulaient parmi les combattants avec des calebasses d’eau et des paniers de vivres, et des paysans se tenaient aux côtés de guerriers aguerris. Ils étaient là parce que l’Empereur Ménélik II et l’Impératrice Taytu les avaient appelés, non avec des promesses de richesses, mais avec cette vérité simple : si l’Éthiopie tombait, la liberté de leurs enfants tomberait avec elle.
De l’autre côté des collines, l’Empire italien avançait avec ses fusils, ses canons et son arrogance impériale. Ses officiers étaient convaincus que l’Éthiopie serait soumise avant le coucher du soleil, réduite à une colonie de plus sur la carte dessinée à Berlin. Mais à mesure que le soleil montait dans le ciel, les cors résonnaient dans les vallées. L’armée de Ménélik se lança à l’assaut, non comme des provinces éparpillées, mais comme une seule nation. La bataille fit rage pendant des heures, l’air saturé de poussière et de fumée, mais c’est l’unité qui emporta la décision. Au crépuscule, dix-sept mille soldats italiens étaient morts ou capturés. Adoua n’était pas seulement une victoire. C’était une déclaration : l’Afrique, unie, pouvait résister à la conquête impériale. Un message écrit dans le sang et le sacrifice, transmis par les historiens à la mémoire des générations, prouvant que la souveraineté peut être défendue quand un peuple se lève ensemble.
L’Afrique connaît cette leçon. Nous l’avons vécue encore et encore. Les institutions ne s’effondrent pas parce qu’elles sont faibles, mais parce que ceux qui devraient les défendre choisissent le silence. Les blessures d’AfriNIC nous ont montré ce qui arrive quand les gardiens s’endorment et que des mains étrangères trouvent des fissures dans nos fondations. Six millions d’adresses IP africaines, détournées, ne l’ont pas été en une seule nuit. Elles ont été prises en plein jour, à travers des failles juridiques et la complicité. Cela ne doit plus jamais se reproduire.
Mais cette note n’est pas un faire-part de décès. C’est un appel. AfroDIG, le Dialogue Africain sur la Gouvernance de l’Internet, est né de cette urgence. Ce n’est pas une plateforme de plus pour orner nos calendriers. C’est un bouclier, un lieu de rassemblement, un rappel que l’Afrique ne cédera pas sa souveraineté numérique au silence ou à des étrangers qui prennent nos réseaux pour une terre sans maître.
AfroDIG est l’endroit où nous réunissons gouvernements, universités, société civile, innovateurs et citoyens pour affirmer clairement : notre Internet est à nous de gouverner. Nos infrastructures critiques ne sont pas des jetons d’échange. Nos identifiants, nos noms, nos numéros, nos biens communs numériques doivent rester africains.
Il ne s’agit pas de nostalgie institutionnelle. Il s’agit de survie. Quand le routage s’effondre, les hôpitaux s’éteignent. Quand les numéros sont détournés, les banques trébuchent. Quand les noms sont effacés, les États perdent leur voix dans l’espace numérique. Il s’agit de souveraineté dans son sens le plus profond, non pas celle inscrite dans les traités, mais celle vécue dans les câbles, les adresses et l’architecture invisible qui permet à l’Afrique d’exister en ligne.
Nous nous souvenons aussi de ceux qui sont venus avant nous. Les pères fondateurs de la gouvernance numérique africaine, qui ont osé rêver alors que le monde doutait de la capacité de l’Afrique à bâtir et gérer ses propres institutions. Ils ont semé les graines d’AfriNIC, des premiers forums régionaux sur la gouvernance de l’Internet, des réseaux de recherche, des points d’échange communautaires. Ils se sont tenus à l’intersection de la politique et de la technologie, affirmant que l’Afrique devait avoir sa propre voix et son propre espace dans les biens communs numériques. AfroDIG s’élève dans leur esprit, honorant leurs sacrifices et prolongeant leur vision dans l’avenir.
AfroDIG n’est pas là pour se lamenter. Il est là pour organiser. Pour parler avant que le silence ne devienne complicité. Pour enseigner, défendre, imaginer et agir. Nous n’attendrons pas une autre blessure pour comprendre que la vigilance est vitale. Nous ne laisserons pas un autre bien public être drainé pendant que nous débattons du processus. AfroDIG commence parce que le temps de l’hésitation est terminé.
Dans les semaines à venir, nous organiserons un webinaire pour parler plus ouvertement de cette vision, écouter vos voix et identifier les leaders régionaux ainsi que ceux qui, depuis longtemps, soutiennent discrètement ce rêve. AfroDIG n’est pas le projet d’un seul. C’est une œuvre collective, un effort communautaire, un devoir continental.
Et ainsi, à mes frères et sœurs africains, le message est simple : le village doit se réveiller tant que la maison tient encore. AfroDIG est notre lieu de rassemblement. Entrez-y. Façonnez-le. Protégez-le. Faites-le respirer de votre présence. Car l’Internet que nous défendons n’est pas une machine. C’est notre mémoire, notre identité, notre souveraineté, notre avenir.
Le loup reviendra, avec des contrats, avec des procès, avec des discours polis. Mais cette fois, qu’il trouve un continent éveillé, uni, et prêt à dire sans trembler : Vous ne passerez pas.
Aluta continua.
Camarade Emmanuel Elolo Agbenonwossi
Connu sous le nom d’Emmanuel Vitus
Au nom de l’équipe d’AfroDIG