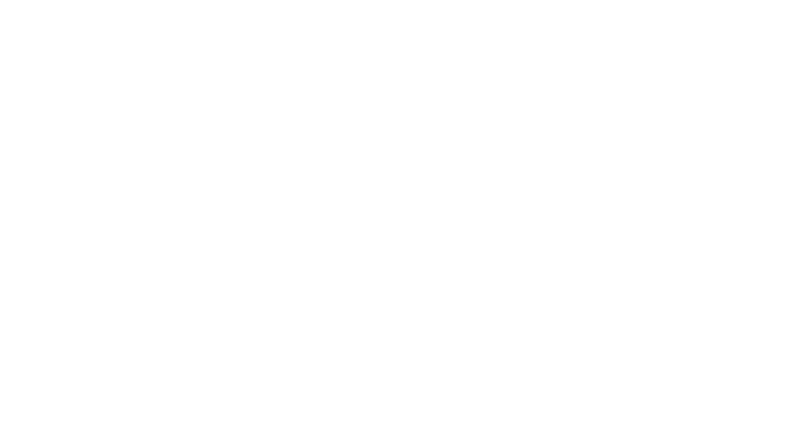Dans le vacarme des nations qui s’élancent dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, l’Afrique avance à contretemps, riche de tout ce que le monde convoite mais souvent absente là où se forgent les règles. Les terres rares extraites de ses sous-sols alimentent les puces des supercalculateurs, ses métaux irriguent les circuits des data centers, ses territoires deviennent l’arrière-cour d’une géopolitique numérique sans consultation préalable. Pendant qu’à Kinshasa la rumba résonne et que les querelles intestines fracturent le tissu national, des accords historiques se signent à la Maison Blanche entre Kigali et Washington, permettant à une puissance étrangère d’exploiter en toute légalité les ressources du Congo. Sans débat, sans transparence, sans voix congolaise à la table.
Et au même moment, sur le front de l’infrastructure technique, c’est un autre pan de souveraineté qui vacille. AfrINIC, le registre Internet régional pour l’Afrique, vacille sous le poids de litiges, d’attaques juridiques et d’une indifférence coupable. Si cette institution venait à disparaître, le continent retournerait sous la tutelle des registres régionaux du Nord, brisant des décennies de construction autonome. Ce serait un recul historique, non seulement en matière de gestion technique, mais aussi de vision. Car il ne s’agit pas seulement de numéros IP, il s’agit de dignité numérique.
Dans une de mes récentes dissertations à l’Université de Malte, j’ai défendu l’idée que toute gouvernance éthique de l’intelligence artificielle en Afrique doit s’émanciper des paradigmes importés, et s’ancrer dans des philosophies relationnelles comme celle d’Ubuntu. Loin des idéaux d’un Wakanda fantasmé ou des stratégies nationales sur papier glacé rédigées à la hâte, il s’agit de construire un cadre enraciné, lent, patient, mais porteur d’une vision africaine du monde. Une vision dans laquelle les humanités africaines, nos langues, nos sagesses et nos institutions ne sont pas des décorations symboliques mais des piliers opérationnels. Comme le souligne Souleymane Bachir Diagne, universaliser ne consiste pas à imposer une norme globale, mais à faire dialoguer les humanités entre elles, dans le respect de leurs altérités.
L’enjeu est clair. Ne pas se laisser dominer par les récits d’ailleurs. Ne pas se contenter de connecter nos territoires sans questionner les architectures qui les gouvernent. Ne pas sombrer dans la dépendance numérique alors même que le sol que nous foulons est celui où reposent les fondations matérielles de l’intelligence artificielle mondiale. Il est temps que l’Afrique prenne la parole, dans ses propres langues, avec ses propres institutions, et dans sa pleine verticalité historique.
Les rails de l’intelligence artificielle sont posés en Afrique
On parle souvent de l’Afrique comme d’un continent à la traîne dans la révolution numérique, mais rares sont ceux qui observent où s’ancrent les fondations matérielles de cette révolution. Les puces qui alimentent les supercalculateurs, les batteries qui font tourner les data centers, les composants qui irriguent les cerveaux artificiels de demain reposent sur un socle invisible et décisif. Ce socle est africain. Dans les entrailles de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de la Zambie ou du Mali se concentrent les minerais critiques sans lesquels l’intelligence artificielle serait privée d’énergie. Coltan, cobalt, lithium, terres rares, autant de ressources extraites dans des conditions souvent violentes, toujours opaques, et trop rarement soumises à la souveraineté réelle des peuples concernés.
Ce que les grandes puissances appellent infrastructure, l’Afrique le fournit en silence. Les routes du numérique sont posées sur ses sols, mais sans ses voix. Le 26 juillet 2025, un traité de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé à Washington, présenté par Donald Trump comme un tournant historique. Derrière les caméras de l’Oval Office et les sourires diplomatiques, le texte prévoit notamment le désarmement et le désengagement des groupes armés dans l’est congolais, sans préciser les modalités concrètes ni les responsabilités. Le plus troublant reste le soupçon grandissant que cet accord s’est noué autour d’une concession implicite. La paix aurait été échangée contre un accès sécurisé aux minerais critiques. Le silicium de demain se négocierait donc dans le silence des peuples d’aujourd’hui.
L’Afrique ne peut plus être perçue comme un simple réservoir logistique pour le monde numérique. Elle ne peut plus être réduite à une géographie de l’approvisionnement sans gouvernance. Elle est un continent pensant, un continent de systèmes, un continent de visions. Elle possède non seulement les matériaux pour alimenter l’intelligence artificielle mondiale, mais également les ressources conceptuelles pour participer à l’écriture de son architecture éthique, politique et sociale. Elle a ce qu’il faut pour universaliser à égalité.
Comme le rappelle Souleymane Bachir Diagne, universaliser ne revient pas à imposer un modèle unique. Il s’agit d’élargir l’universel à partir de la diversité des expériences humaines. L’Afrique, forte de ses cosmologies, de ses langues et de ses philosophies de la relation, doit affirmer qu’elle n’est pas destinée à rester l’arrière-cour de la révolution cognitive mondiale. Elle en est déjà la base matérielle. Elle peut et doit désormais en devenir l’âme conceptuelle.
Cependant, il ne suffit plus d’identifier les injustices. Il ne suffit plus de dénoncer les asymétries, de cartographier les extractions ou d’aligner les statistiques. L’Afrique ne peut plus attendre qu’on lui accorde une place à la table. Elle doit concevoir et dresser sa propre table. Il devient impératif de dépasser les discours, les promesses répétées et les récits de victimisation. Le moment exige des politiques publiques audacieuses, capables d’adosser l’exploitation minière à des stratégies claires de souveraineté numérique. Il impose la formation d’alliances régionales fortes, à même d’influencer la gouvernance mondiale de l’IA. Il appelle enfin à défendre sans détour nos institutions techniques africaines, comme AfriNIC, qui restent les piliers discrets de notre autonomie numérique.
Je défends l’idée que l’Afrique ne doit pas seulement prendre part aux débats éthiques sur l’intelligence artificielle. Elle doit en proposer les fondements. À partir de philosophies relationnelles telles que l’Ubuntu, elle peut offrir une gouvernance de l’IA fondée non sur la seule performance, mais sur la reconnaissance mutuelle. Une gouvernance qui privilégie la réparation à la prédiction, l’interdépendance à l’accumulation. Cette vision n’est pas un rêve lointain. Elle est opérationnelle. Elle appelle à une réécriture des cadres conceptuels, à une désoccidentalisation des normes, et à une affirmation lucide selon laquelle la souveraineté réelle commence dans les idées avant de s’incarner dans les machines.
AfriNIC ne doit pas sombrer car la dépendance ne pardonne pas deux fois
Au cœur de l’infrastructure numérique africaine, il existe une institution discrète que peu connaissent mais dont la disparition compromettrait les ambitions de souveraineté du continent. AfriNIC, le Registre Internet régional pour l’Afrique, alloue les ressources numériques qui sont aux réseaux ce que les parcelles sont à la terre. Sans ce registre, pas d’adresses IP, pas d’identifiants fiables, pas d’architecture stable pour les services publics en ligne, pour les banques, pour les universités, ni pour les hôpitaux connectés. À l’heure où l’intelligence artificielle devient un pilier stratégique, l’Afrique ne peut se permettre de voir sombrer un instrument aussi central.
Laisser AfriNIC s’effondrer sous les coups croisés d’intérêts privés, d’inertie judiciaire et d’aveuglement politique reviendrait à revenir à une ère d’hétéronomie numérique. Cela signifierait déléguer à nouveau la gestion de nos ressources critiques aux registres d’Internet du Nord, comme au temps où l’Afrique n’avait pas encore de voix propre dans l’architecture du réseau. Ce serait une régression historique. Ce serait effacer vingt ans d’efforts communautaires, techniques, diplomatiques et politiques.
Il ne s’agit pas ici de défendre une institution par réflexe conservateur. Il s’agit de comprendre que certaines infrastructures, parce qu’elles organisent l’accès, la régulation et l’équité dans l’environnement numérique, relèvent du bien commun. AfriNIC est l’une d’entre elles. Sa chute provoquerait une fragmentation profonde de l’espace numérique africain, un retour à la dépendance, une perte de contrôle sur les flux, les usages, et les innovations. Cela affecterait directement la capacité des États à mettre en œuvre des politiques publiques numériques cohérentes. Cela mettrait en péril les ambitions d’indépendance cognitive que nous formulons aujourd’hui dans le champ de l’IA.
Il faut le redire avec force. On ne construit pas de souveraineté avec des institutions sous tutelle. On ne gouverne pas les données africaines à partir de serveurs distants, ni les identités numériques à partir de normes importées. La souveraineté commence par la maîtrise des registres, des normes, des protocoles. Elle s’exprime par la capacité à créer, protéger et faire évoluer des communs techniques. C’est dans cette logique que s’inscrivent les Lignes directrices pour une intelligence artificielle éthique, inclusive et responsable en Afrique francophone. Ce document, fruit d’un processus collectif, reconnaît que l’IA n’est pas seulement une affaire d’algorithmes, mais aussi une affaire d’infrastructure, de contexte, de justice.